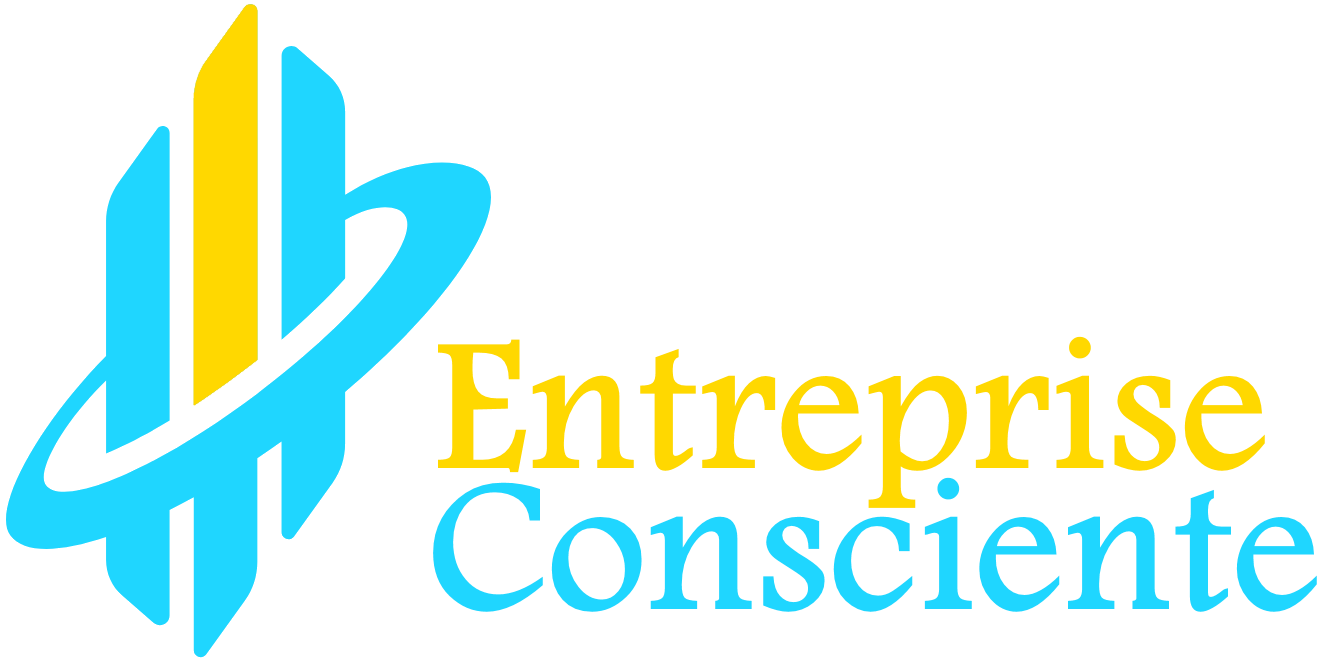Qu’est-ce qu’un cercle de co-développement et pourquoi l’utiliser ?
Un cercle de co-développement professionnel est une méthode d’apprentissage entre pairs, fondée sur l’intelligence collective. Mise au point par Adrien Payette et Claude Champagne au Québec dans les années 1990, cette approche consiste à réunir un petit groupe de professionnels (6 à 8 personnes) qui se rencontrent régulièrement pour résoudre des problématiques concrètes liées à leurs pratiques professionnelles, à travers une méthode structurée.
Dans un monde professionnel qui évolue rapidement, les silos dans les entreprises peuvent freiner l’innovation et l’engagement des collaborateurs. Les cercles de co-développement offrent des espaces de parole sécurisés favorisant l’entraide, le développement des compétences et la coopération transverse. Ils sont particulièrement adaptés aux environnements en transformation qui cherchent à stimuler l’autonomie, la responsabilité et la co-construction des solutions.
Les étapes pratiques pour mettre en place un cercle de co-développement
Mettre en place un cercle de co-développement nécessite une préparation rigoureuse et l’utilisation d’outils éprouvés. Voici les étapes clés pour assurer une mise en œuvre efficace au sein de votre organisation :
Identifier un objectif clair : Le cercle doit répondre à un besoin identifié : améliorer la collaboration, favoriser le leadership, accompagner le changement, résoudre des problèmes métiers, etc.
Constituer le groupe : Idéalement, 6 à 8 membres issus de fonctions ou départements différents mais ayant des enjeux professionnels similaires. Évitez d’intégrer un supérieur hiérarchique dans le groupe pour garantir la liberté de parole.
Former un animateur : La présence d’un animateur formé à la méthode est essentielle pour structurer les échanges et veiller au respect du cadre. Cela peut être un manager, un coach interne ou externe.
Planifier la première session : Chaque session dure généralement entre 2 et 3 heures et suit un déroulé précis en 6 étapes, centré sur un « client » qui présente sa problématique.
Utiliser une méthode structurée : La méthode originelle Payette/Champagne est la plus utilisée. Elle comprend les étapes suivantes : exposé de la situation par le « client », clarification par les « consultants », contrat de consultation, consultation, consolidation des apprentissages et évaluation.
Répéter les sessions régulièrement : Un cercle durable se réunit idéalement toutes les 4 à 6 semaines. Cela permet de maintenir une dynamique d’apprentissage et de soutien mutuel.
Étude de cas : le groupe SNCF poursuit son virage culturel grâce aux cercles de co-développement
Le groupe SNCF a expérimenté à grande échelle l’utilisation des cercles de co-développement dans le cadre de sa transformation culturelle engagée depuis 2017. Face aux enjeux de digitalisation et de transversalité, la direction des ressources humaines a décidé d’outiller ses managers et collaborateurs avec des dispositifs favorisant le travail collaboratif et la responsabilisation. Ces cercles ont été introduits notamment pour soutenir les managers de proximité confrontés à des situations complexes.
Des animateurs internes ont été formés à la méthode Payette/Champagne via des formations dispensées en partenariat avec des cabinets spécialisés. Chaque cercle choisi portait sur une thématique précise : soutien au leadership, gestion du changement, développement des postures coach, etc.
Les résultats ont été mesurables :
Amélioration de la posture managériale : 78 % des participants ont déclaré avoir amélioré leur capacité d’écoute et de questionnement.
Montée en compétences collectives : Des solutions apportées dans un cercle ont été répliquées dans d’autres équipes, décuplant l’impact organisationnel.
Renforcement de la transversalité : Les groupes mélangeaient différents métiers et directions, favorisant la désilotisation.
Outils et technologies pour faciliter les cercles de co-développement
Bien que la méthode se base sur une dynamique humaine, certains outils numériques peuvent renforcer l’impact des cercles, notamment en contexte hybride ou distanciel :
Zoom ou Microsoft Teams : Pour organiser les sessions à distance. Des fonctionnalités comme les salles en sous-groupe facilitent les temps de travail par binôme ou petit groupe.
Klaxoon : Outil collaboratif permettant de documenter les cycles de co-développement, de partager les apprentissages et de conserver les traces des échanges.
Miro ou MURAL : Pour structurer les étapes de la démarche en visuel (cartes de questionnement, fiches problème, etc.). Très utile pour animer les phases de clarification et de consolidation.
Canal Slack ou Teams dédié : Il est pertinent de créer un canal entre deux sessions pour maintenir la dynamique, échanger des ressources ou prendre des nouvelles des actions mises en œuvre.
Conseils pratiques pour mobiliser les collaborateurs et maintenir la dynamique
Pour que les cercles de co-développement produisent des bénéfices durables, certaines conditions doivent être réunies :
Encadrer la démarche sans la hiérarchiser : Les cercles fonctionnent mieux sans pression managériale directe. Il est donc recommandé de sponsoriser la démarche tout en laissant les groupes autonomes dans leur organisation.
Favoriser la sécurité psychologique : L’adhésion repose sur la confiance et la bienveillance. Dès la première session, le codex du groupe doit être co-construit : confidentialité, non-jugement, écoute active.
Capitaliser sur les apprentissages : Instaurer une « veille partagée » en demandant à chaque membre de documenter ses apprentissages et leurs effets concrets sur le terrain.
Offrir des témoignages inspirants : Faire témoigner un collaborateur ayant bénéficié d’un cercle auprès d’autres équipes peut susciter l’envie. Des vidéos internes ou des séminaires de retour d’expériences sont souvent efficaces.
Les bénéfices prouvés du co-développement en entreprise
Les retours d’expérience d’entreprises telles que Orange, La Poste ou la MAIF montrent que la méthode de co-développement peut produire des résultats très concrets, au-delà de l’apprentissage entre pairs. Voici les principaux bénéfices documentés :
Amélioration des capacités de résolution de problème : En mobilisant l’intelligence collective, les participants acquièrent une plus grande agilité à faire face aux situations complexes.
Développement de soft skills clés : L’écoute active, la communication bienveillante, la posture de questionnement gagnent en profondeur à chaque session.
Engagement et responsabilisation : Se sentir écouté et pouvoir contribuer aux problématiques d’autrui accroît le sentiment d’appartenance et de responsabilité dans l’entreprise.
Transformation culturelle en profondeur : En diffusant peu à peu cette culture de la co-construction, les cercles facilitent la transformation managériale vers plus d’autonomie et de co-responsabilité.
Conclusion opérationnelle : passer à l’action
Les cercles de co-développement ne nécessitent ni gros investissements ni changements structurels. Ils s’intègrent dans les organisations existantes comme des leviers subtils mais puissants d’évolution culturelle. Pour passer à l’action :
Identifiez un petit groupe pilote prêt à expérimenter la méthode dans une logique de test-and-learn.
Formez un ou deux animateurs internes ou faites appel à un facilitateur externe.
Planifiez 3 à 5 sessions dans un calendrier fixe pour ancrer la dynamique.
Recueillez des feedbacks à chaque session pour améliorer la démarche.
Communiquez sur les résultats obtenus pour inspirer d’autres équipes.
En favorisant le développement personnel et collectif, le co-développement s’impose comme un outil précieux pour renforcer l’agilité des organisations et dynamiser le capital humain de manière collaborative.